





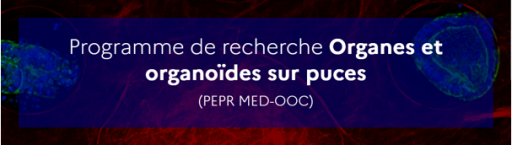
Le programme de recherche exploratoire Organes et organoïdes sur puces (PEPR MED-OOC) vise à déployer en France une nouvelle génération de modèles biologiques grâce au développement d’organes et d’organoïdes sur puces (O&OoC).
L’État a confié son pilotage au CEA, au CNRS et à l’Inserm, et la direction scientifique à Xavier Gidrol (CEA), Anne-Marie Gué (CNRS), et Maxime Mahé (Inserm).
MED-OOC est financé par France 2030 sur 6 ans et dispose d’un budget de 48,4 M d’¤ opéré par l’ANR.
4 projets :
![]()
Le réseau thématique Inserm organoïdes (RTO) a été créé en juin 2025 avec comme porteurs du projet : Audrey Ferrand (Inserm) et Vincent Flacher (CNRS).
La gouvernance est assurée par :
Deux coordinateurs du réseau : Franck Lethimonnier (Directeur de l’Institut Technologies pour la Santé) pour l’Inserm et Monique Dontenwil (Directrice adjointe scientifique de la Section 28 Pharmacologie-ingénierie et technologies pour la santé – Imagerie biomédicale) pour le CNRS.
Un Comité de Pilotage de 17 personnes d’appartenances multiples (Inserm, CNRS, CEA et INRAE)
Le RTO s’inscrit dans la continuité du Groupe de Travail de l’ITMO Technologies pour la Santé d’Aviesan (2018-2021) et du Groupement de Recherche CNRS ‘Organoïdes’ (2021-2025). Ce réseau de plus de 300 membres (162 INSERM, 77 CNRS, 85 Universités, 35 INRAE, 14 CEA) issus de laboratoires d’excellence de 26 villes a contribué à l’émergence des PEPR BBTI ‘Biothérapies et Bioproduction de Thérapies Innovantes’ et MED-OOC ‘Organes et organoïdes sur puces’. Les actions du GDR portent sur 5 axes :
Sur la base des réalisations antérieures et des divers programmes nationaux impliquant ces modèles en partenariat avec différentes structures existantes et acteurs académiques, la structuration nationale autour des organoïdes sera poursuivie afin de promouvoir leur utilisation dans les cadres académique, clinique et privé/industriel, dans le respect des réglementations et de l’éthique. Cette structuration se fera par l’organisation d’évènements, le partage de connaissances et l’information du grand public et des décideurs. Elle inclura les différentes applications suivantes : Modélisation de pathologies, Médecine régénérative, Biobanques, Découvertes de biomarqueurs, Criblage de drogues et Toxicité. Tous ces efforts conjoints permettront d’intégrer les organoïdes dans les stratégies de recherche biomédicale avancée et de médecine de précision.
Des actions communes à ces domaines favoriseront le transfert vers les industriels en s’appuyant sur le réseau des intégrateurs, notamment OBBI (bioproduction), la structuration de filières industrielles comme F3OCI (French Organ & Organoid On Chip Initiative), et le transfert vers la clinique (PEPRs BBTI, MED-OOC, Santé numérique, SaFe, SAMS…).
Une prochaine étape de développement du réseau visera à diversifier l’offre de service en termes d’usages pour répondre aux enjeux décrits en introduction. Cela conduira progressivement à la constitution des réseaux thématiques dédiés par famille d’usage. Le RTO aura alors une mission nationale importante pour garantir les interactions scientifiques transverses aux différents réseaux thématiques.
Le périmètre du Pôle IA et numérique concerne les activités de recherche des unités Inserm utilisant l'IA et le numérique dans leur ensemble. Le Pôle implémente un lien transversal aux différents domaines de recherche et Instituts Thématiques de l'Inserm, donnant à l'institut une vision globale de l’activité en IA et numérique et permettant de définir une stratégie. Le Pôle élabore aussi des recommandations liées à l'usage de l'IA et du numérique dans l'institut, en lien avec les autres acteurs sur ce point (comité d'éthique, Lorier, DPO...). Enfin, le Pôle met en place des dispositifs pour accompagner la montée en capacité de nos équipes de recherche en IA et numérique, en lien avec la DSI et l'environnement ESR.
Prix Innovation - Inserm décerné à Sarah Zohar (DR INSERM), directrice de l’équipe projet HeKA (Inserm, Inria, Université Paris Cité), pour ses travaux sur l’évaluation des médicaments et dispositifs médicaux numériques."
Prix Axa décerné à
1- Fabrizio de Vico Fallani (DR INRIA) - l’Institut du Cerveau – Fondation ICM - Paris, pour son projet RECOVER : une nouvelle approche de rééducation post-AVC non invasive basée sur des interfaces cerveau-ordinateu.
2- Stein Silva (PU-PH) - UMR Tonic dirigé par Pierre Payoux - Université de Toulouse, CHU de Toulouse, pour son projet AWAKEN : noxic coma: Wakefulness And Knowledge Enhancement through Neurotech.
Prix Raymond Rosen 2025 de la FRM décerné à
Isabelle Fournier (DR INSERM) - UMR 1192 PRISM - Lille, pour son projet SPIDERMASS : Technologie innovante pour guider la chirurgie du cancer.
Prix Irène Joliot Curie 2025 de l'Académie des Technologies, prix de la "Femme scientifique de l'année" décerné à
Valentina Emiliani (DRCE CNRS) - UMR 968 Institut de la Vision- Paris